« Il n’existe aucune synthèse contemporaine sur le commerce des fourrures qui égale celle de [Harold] Innis, peut-être parce que le « commerce des fourrures » ne semble plus être un sujet en soi. »[1]
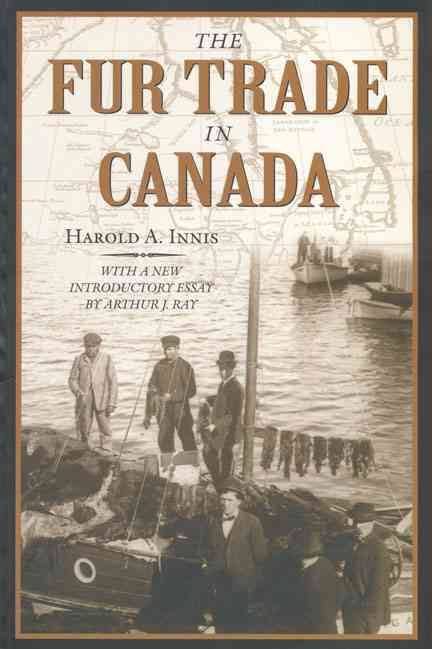 À supposer, comme le soutient ici Allan Greer, qu’une pareille synthèse soit peu envisageable aujourd’hui – pour des raisons que nous éluciderons ci-dessous – comment appréhender alors les « effets secondaires » de ce commerce de l’époque coloniale, comme la traite illégale en pelleteries entres les colonies « ennemies » de la Nouvelle France et de la Nouvelle Angleterre ? La traite illégale fut-elle, comme le soutenait le chanoine Groulx, « le baril percé de la colonie[2] » ? Ou fut-elle plutôt une simple anomalie du grand commerce « régulier », comme le supputait Harold Innis[3] ?
À supposer, comme le soutient ici Allan Greer, qu’une pareille synthèse soit peu envisageable aujourd’hui – pour des raisons que nous éluciderons ci-dessous – comment appréhender alors les « effets secondaires » de ce commerce de l’époque coloniale, comme la traite illégale en pelleteries entres les colonies « ennemies » de la Nouvelle France et de la Nouvelle Angleterre ? La traite illégale fut-elle, comme le soutenait le chanoine Groulx, « le baril percé de la colonie[2] » ? Ou fut-elle plutôt une simple anomalie du grand commerce « régulier », comme le supputait Harold Innis[3] ?
Assurément, ces tractations qui « n’auraient pas dû avoir lieu » offrent déjà peu de lisibilité – ni aux contemporains du commerce illicite, ni aux historiens qui se sont penchés sur ces questions. Mais allons à l’essentiel et répondons à notre question de départ : pourquoi ce chant de cygne des études fondatrices sur la traite des fourrures ? Ce qui est certain, c’est que tout objet d’étude historique existe dans un cadre d’étude donné. Toute problématique historienne fait référence à un (ou plusieurs) cadre(s) historiographique(s). Harold Innis, pour sa part, fut une grande figure de l’histoire économique du Canada. Alors si l’étude de la traite des fourrures comme « phénomène économique » n’est plus d’actualité, pourquoi est-ce le cas ? L’existence d’une activité illicite en parallèle au commerce légal aurait-elle menacé l’intégrité conceptuelle de la « traite des fourrures » ?
Comme nous allons le voir, la problématisation de l’objet « traite des fourrures » vient de toutes parts. Il faudrait toutefois accorder une mention honorable aux générations récentes d’historiens qui se sont penchés sur l’histoire sociale du Québec, et l’ethnohistoire des rapports amérindiens-européens. Grâce à leurs travaux « révisionnistes », le vieux centre gravitationnel de l’histoire économique est devenu orbital, à son tour. Il ne nous reste qu’à déceler les nouveaux pôles d’attraction qui fixent l’étude historique de la traite.
 Dans l’article qui suit, nous allons nous concentrer sur les cadres historiographiques qui ont, pour ainsi dire, « décentré » l’étude traditionnelle de la traite des fourrures, pour y inclure les phénomènes plus « indigestes » telles la traite illicite, la guerre économique entre petites et grandes puissances, les relations complexes entre métropole et colonie, et enfin, les relations européennes-amérindiennes dans une espace dit « frontalier »[4]. Notre objectif sera de fournir un bilan du renouveau conceptuel occasionné par les objets historiques « décentrants ».
Dans l’article qui suit, nous allons nous concentrer sur les cadres historiographiques qui ont, pour ainsi dire, « décentré » l’étude traditionnelle de la traite des fourrures, pour y inclure les phénomènes plus « indigestes » telles la traite illicite, la guerre économique entre petites et grandes puissances, les relations complexes entre métropole et colonie, et enfin, les relations européennes-amérindiennes dans une espace dit « frontalier »[4]. Notre objectif sera de fournir un bilan du renouveau conceptuel occasionné par les objets historiques « décentrants ».
Dans notre cas particulier, ce renouveau se trouve à la jonction de trois historiographies de tendance : l’histoire transfrontalière, la nouvelle histoire des Empires, et l’ethnohistoire des rapports amérindiens-européens. En analysant les divers regards posés sur le commerce illicite par chacun de ces courants historiographiques, nous pourrons ainsi redéfinir notre objet d’étude – « la traite illicite » – à la lumière de cadres précis, tout en évitant d’en faire un objet figé, un idéaltype, ou encore : l’anomalie d’un « phénomène structurant ».
Mercantilisme: fin d’un concept ?

Harold Innis fut une figure importante dans l’étude de la traite des fourrures à titre de phénomène historique structurant – de la base économique coloniale, de l’élan colonisateur, des rapports interculturels, et des formes politiques propres au Canada[5]. Ses héritiers reviennent souvent sur les présupposés libéraux qui sillonnent son analyse de la traite, et sa « staples theory ». Malgré son indéniable originalité, l’analyse économique d’Innis était empreinte de schèmes « déterministes » concernant les grandes orientations du commerce colonial[6]. Fait curieux : on peut toujours apercevoir les contours de ces vieux débats dans ce que l’on nomme aujourd’hui la controverse mercantiliste.
Rarement une expression eut elle une si longue et mauvaise vie que celle du mercantilisme. Pour nous éviter le brouillard intellectuel entourant cette controverse, nous avons déjà auparavant traité du cas français du mercantilisme en nous bornant à la politique coloniale du ministre Colbert[7]. Or, dans le cadre élargi de la nouvelle histoire des Empires, il nous faudra plutôt nous tourner vers le débat anglo-saxon sur le mercantilisme, afin de chercher des pistes de solution à l’éclatement du vieux consensus historiographique dont se nourrissait H. Innis.
Nous avons retenu l’apport de deux chercheurs, Jonathan Barth[8] et Steve Pincus[9], pour démêler ce contentieux. L’enjeu historiographique autour de cette question est de taille : comment décrire les rapports économiques de la sphère atlantique du XVIIIe siècle, et poser un cadre qui transcende les catégories de commerce « licite » et « illicite », tout en évitant une analyse anachronique de ces rapports ?
À cet effet, nos chercheurs ont tous deux refusé de jeter le bébé du mercantilisme avec l’eau du bain de l’anachronisme. D’une part, le mercantilisme est une désignation importante pour envisager le débat intellectuel dans les siècles de l’expansion européenne outre-mer[10]. Certes, il faut se garder d’en faire une « doctrine » universellement répandue chez les commerçants, financiers et hommes d’État des XVIIe et XVIIIe siècles. D’autre part, il est impossible d’ignorer la réaction contre « le mercantilisme », semblable à une lame de fond, contre toute une manière de penser le monde et ses richesses par les penseurs issus des « Lumières » : les physiocrates, les libéraux et plus tard les utilitaristes et les économistes[11].

Barth et Pincus ont chacun découvert une voie de sortie de l’antique consensus libéral sur le « mercantilisme » grâce à un exercice de mise en contexte du débat politique lié aux aléas du premier Empire britannique. Leur véritable divergence se trouve dans leur acception du consensus mercantiliste. Pincus, pour sa part attribue à l’historiographie libérale et impériale la plus grande part de responsabilité dans la création d’un concept mercantiliste monolithique[12]. Selon lui, le concept libéral du « mercantilisme » accordait à une certaine vision (délétère) de l’économie-monde une valeur de consensus, en lui attribuant des traits identifiables : l’activité commerciale comme jeu à somme nulle ; les richesses du monde sublunaire finies, ou limitées ; la richesse d’un royaume mesurée en métaux précieux ; enfin, une politique coloniale orientée sur la subordination de la périphérie au centre.
Vint ensuite la critique de cette vision monolithique du mercantilisme par toute une génération d’historiens, à partir de la fin XIXe siècle jusqu’à présent. On se débarrassa des propriétés dites unitaires et doctrinaires du mercantilisme, toutefois en lui accordant un aspect téléologique[13]. Plus intéressant encore, le débat sur le mercantilisme, entretenu par des générations d’intellectuels, participa à la consolidation des disciplines historiques, économiques et sociologiques[14]. À cet égard, le « mercantilisme » fut un concept fondateur, de par le principe organisateur qui lui donnait sa puissance d’explication[15]. Pincus conclut que la critique portée contre le mercantilisme par les historiens professionnels ne connut pas d’efficacité véritable, par manque de nouveau réseau de concepts ou de métarécits pour remplacer l’ancien consensus[16]. D’où l’ambiguïté qui pèse toujours sur ce sème.

Depuis cette remise en question, historiens et économistes s’en sont remis, plus sagement peut-être, à la richesse des débats entourant le mercantilisme, pour souligner la part indécidable de consensus et de dissension entourant les politiques économiques des puissances durant les siècles de l’expansion européenne outre-mer[17]. Pincus, pour sa part, situe le consensus intellectuel au niveau d’une vision statique de l’économie… qui n’aurait finalement pas existé. Ou plutôt, les « principes mercantiles » critiqués par Smith s’avéraient être le cheval de bataille des Tories, riches propriétaires terriens, partisans d’un Empire britannique construit à partir d’un gigantesque land and money grab subtilisé aux empires concurrents[18]. De l’autre côté du House of Commons, les Whigs[19] opposaient une vision plus dynamique – et potentiellement « infinie » – de la richesse, obtenue à partir d’une réorganisation des forces productives de la société, et de l’industrieuse exploitation de ses ressources[20]. Ainsi, en analysant le discours entourant les Navigation Acts, les monopoles commerciaux et la politique coloniale du royaume anglais, Pincus démontre que le consensus traditionnellement attribué au « mercantilistes » ne représentait qu’une option idéologique dans les débats qui secouèrent la classe politique et le grand public quant à la destinée future du Royaume Uni. Qui plus est, toute la trajectoire du projet colonial, selon Pincus, est infléchie par ces débats tenaces. Ainsi peut-on retrouver l’empreinte Tory dans la formation des monopoles commerciaux[21] et la politique d’expansion territoriale de l’empire[22], et la force d’action des Whigs dans la politique industrielle des colonies[23], et l’essor du capital financier britannique[24].
Pas de fumée impériale donc, sans feu « mercantile » ? Jonathan Barth, pour sa part, postule l’existence d’un certain consensus – ou du moins des « grandes orientations mercantiles » – qui transcendèrent les débats d’époque. Barth localise ce consensus autour des controverses portant sur la politique monétaire des empires, suite à la débâcle espagnole du XVIIe siècle[25]. Malgré les disputes historiennes entourant le mercantilisme depuis Smith, Barth revendique le caractère unificateur autour d’une conception « mercantiliste » de l’argent, ce qu’il appelle le specie objective :
« Mercantilism was not a static theory but rather a highly dynamic analytic lens permitting a striking multiplicity of economic visions. Diversity, however, arose out of consensus: out of the common supposition that a favorable balance of trade and the resulting influx of money into a country—the balance-of-trade doctrine and specie objective—were the principal means to power and plenty. »[26]
Pour Barth, l’effacement des consensus intellectuels par prétexte d’une « diversité d’opinion » prive les historiens d’une problématique importante concernant la formation des empires coloniaux : le substrat idéologique de la conquête commerciale[27]. Barth propose à cet effet de revoir la problématique impériale sous l’angle du specie objective, des politiques monétaires mercantilistes et des débats entourant la balance commerciale dans l’Angleterre du XVIIe et XVIIIe siècle.

Si, selon Barth, il n’y a pas « d’acte de naissance » du mercantilisme à proprement dit, on peut voir un premier « débat mercantiliste » faire surface en Angleterre au moment de la crise économique des années 1620. D’ores et déjà, vers la fin du même siècle paraîtront deux grandes tendances du mercantilisme : le mercantilisme des monopoles, et le mercantilisme du capital industriel[28]. Malgré leurs différentes conceptions de la richesse, les deux « écoles » conservaient la même idée forte de l’argent, comme levier de puissance et comme adjuvant au commerce. Suite à la déconfiture de l’Empire espagnol, l’abandon de l’objectif d’accumulation monétaire marquera, à cet effet, leur point commun[29]. Bref, si les thuriféraires de l’Empire débattaient des finalités de l’Imperium Britannicus, ils s’entendirent, selon Barth, sur les moyens pour parachever leurs ambitions de puissance et de richesse – le commerce, la colonisation et le développement économique. Le specie objective représente donc une nouvelle philosophie des moyens qui allait désormais faire empire.
Vu sous cet angle, le consensus mercantiliste était donc symptomatique d’une nouvelle philosophie d’Empire, « le plan systématique pour la construction et le maintien de l’hégémonie économique impériale »[30] qui orientera l’esprit de l’acteur impérial durant cette période. À cet effet, Barth ajoute une nuance importante :
« It was not a conscious theory but a latent, dynamic system of rational economic inferences, based on the view that the quantity of money bore a direct relationship to the nation’s economic and imperial health. Mercantilism was coherent, compelling, and a critical justification for overseas empire. And yet it was also radically diverse. »[31]
Tout compte fait, nos deux critiques placent les marqueurs du consensus et de la diversité d’opinion à l’égard du mercantilisme à de différents endroits : pour Barth, la doctrine monétaire ; pour Pincus, la vision statique de la richesse. Ce choix, loin d’être anodin, induit une réflexion sur le rôle du débat dans la formation idéologique des élites impériales. Si Pincus propose de reconstituer le mercantilisme dans une dialectique qui oppose deux visions dominantes de la richesse, Barth pour sa part avance l’hypothèse d’un proto-capitalisme d’expansion qui opère dans le giron d’un ordre consensuel, intellectuel et moral, lui-même le produit de débats factieux.
Histoire impériale, ou histoire atlantique ?
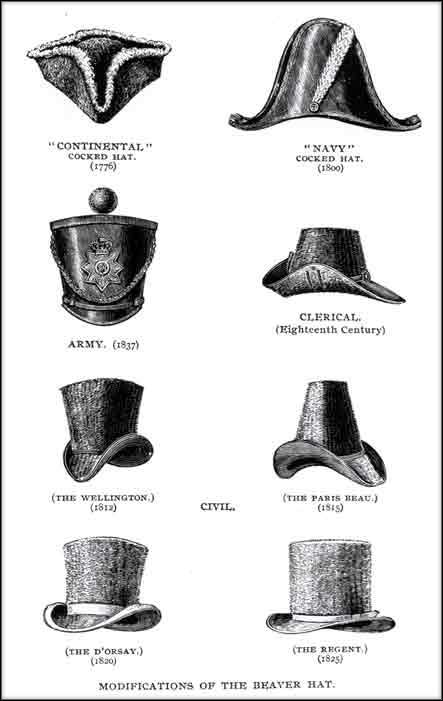
À l’aune de ces analyses, il va sans dire que le mercantilisme et l’expansion impériale des puissances européennes nous semblent des phénomènes intimement liés. Les exégèses de Pincus et de Barth ont pourtant débouché sur deux cadres d’interprétation différents – le premier favorisant une sphère impériale instable et contestée à l’interne, le deuxième mettant de l’avant un consensus impérial façonné par des rivalités entre empires. Trevor Burnard nous permet d’enchaîner sur ce contentieux afin de le situer dans deux traditions historiographiques traitant de l’époque expansionniste : l’histoire impériale, prédominante au Royaume Uni, et l’histoire atlantique, de tendance plutôt (nord-)américaine[32].
Sans tomber dans un banal examen comparatif ou faire le jeu de la préférence, comment faire acte de ces différents cadres d’interprétation ? À nos yeux, la différence significative entre l’histoire atlantique et l’histoire impériale, se trouve dans le décentrement opéré par l’histoire atlantique sur la question du pouvoir impérial, occasionné par la complexification des relations intra- et inter-coloniales. Les premiers indices de ce décentrement, comme l’indique Burnard, se trouve dans les polémiques entourant les coutumes coloniales[33]. Un jugement sur les mœurs en colonie posé de manière quasi-identique du point de vue du « centre » (l’Abbé Raynal, en France) ou de la « périphérie » (le colon proto-américain Crèvecœur), permet d’apprécier une seule et même problématique liée à l’identité des empires[34]. Dans son texte, Burnard propose qu’une rupture ontologique s’est généralisée à l’échelle impériale à partir de l’expérience coloniale. Cette rupture serait à l’origine de la divergence entre paradigme impérial « euro centrique », et paradigme atlantique « spatial ». L’extension coloniale obligera donc une révision des critères à partir desquels il sera désormais possible d’envisager la relation du centre à la périphérie, selon des barèmes d’héritage, privilégiés par l’histoire impériale, ou barèmes d’expérience, privilégiés par l’histoire atlantique[35].
Suivant cette ligne de fracture, les historiens de l’histoire atlantique vont concevoir une histoire des espaces et des peuples avec leur dynamique propre, non-inféodée à l’histoire impériale. Les tenants de cette historiographie privilégieront davantage l’expérience sur l’héritage, et l’environnement dynamique sur la relation de la périphérie au centre[36]. La perspective impériale y sera aussi largement atténuée, puisqu’elle obscurcit la transformation réciproque de peuples et de lieux. Seule l’histoire atlantique avec ses concepts « trans » – « transnationaux, transrégionaux, océaniques, et intégrateurs…[37] » – peut répondre de manière positive à la question du colon Crèvecœur : « qui est ce nouvel homme, l’américain » ?

Cela dit, pour Burnard, on ne peut pas non plus faire complète abstraction du fait impérial dans l’historiographie transfrontalière, tant celui-ci fut un moteur indispensable des dynamiques de flux. L’impérialisme était le système dominant à partir duquel les « sociétés atlantiques » se formèrent, et se structurèrent[38]. Les terres d’Amériques étaient peuplées de sujets coloniaux et « d’ennemis du roi », amérindiens y compris. Cela dit, ce ne fut qu’à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que l’on se mit, selon Burnard, à s’intéresser à l’activité de comparaison entre « empires rivaux »[39]. D’une part, les colonies étaient devenues des sources de puissance et de fierté, et les nouvelles élites « créoles » voulaient à leur tour contribuer au discours « national »[40]. D’autre part, les rivalités croissantes entre puissances impériales à l’issue du Traité d’Utrecht (1713) dirigèrent l’attention de l’opinion sur le rôle joué par les colonies dans l’élaboration de politiques extérieures des royaumes[41].
Nous serions portés à conclure que l’exercice comparatif, aussi antique soit-il, renaît périodiquement de ses propres cendres dans les moments de crise. Toute tentative de pensée systématique sur une puissance impériale, semble-t-il occasionne la comparaison à l’envi de ses rivales. Les temps de crise impériaux désormais échus, l’analyse comparative privilégiée par la nouvelle histoire des Empires s’effectue toutefois majoritairement du point de vue des traditions historiographiques nationales : anglaises, françaises, espagnoles, etc.[42]
Histoire atlantique, figure du « sans-frontiérisme » contemporain ?

Dans le cas de la Nouvelle France, un choix intéressant se présente à nous : faut-il poser un cadre historiographique de l’espace atlantique pour mettre l’accent sur les rapports de force, ou sur les relations transfrontalières, par exemple les circulations – de personnes, de marchandises, de cultures, etc. ? Par simple effet de nouveauté, on pencherait plutôt pour la deuxième option. C’est pour le moins la première impression que nous donne l’article d’Aline Charles et de Thomas Wien sur l’histoire du Québec comme « histoire connectée »[43]. En faisant exploser le cadre historiographique traditionnel, orienté sur les divers occupants d’un territoire et leurs avanies et exploits respectifs, Charles et Wien rappellent que certains phénomènes, difficilement perceptibles dans la perspective territoriale, obtiennent une visibilité toute indiquée sous l’optique des circulations transfrontalières.
Bien que leur article mette en exergue un Québec à travers le temps[44], nous porterons notre attention sur la section traitant de l’époque coloniale. Wien, spécialiste de la Nouvelle France, démontre, à partir de l’exemple des migrations de populations, comment un décentrement du regard peut illuminer des dynamiques fondamentales à l’expérience coloniale. Le résultat de cette dynamique, il est vrai, a toujours été « criant » dans l’historiographie des rapports de force[45]. Seulement, comme insiste Wien, une « histoire connectée des migrations » restitue l’importance de la dynamique migratoire dans tout l’espace atlantique. À cet effet le contraste entre les migrations françaises vers le Canada et vers les Caraïbes est frappant, et nous rappelle qu’à l’intérieur d’un seul empire, l’espace transocéanique fut avant tout un espace de migration de main-d’œuvre. En bref, les “habitants” français qui migrèrent au Canada furent pour une grande majorité… des migrants économiques[46].
Le Canada s’insère aussi, comme le souligne Wien, dans l’espace continental américain. Le contact inter colonial, échappant aux prescriptions colbertistes de loyauté économique des colonies à l’égard de la métropole, fit office d’une « intense circulation de commerçants et de transporteurs (dont beaucoup d’Amérindiens) »[47], entre Montréal et Albany (NY), particulièrement au XVIIIe siècle. Formulé du point de vue transfrontalier, « l’activité déloyale » du commerce illicite créa une zone de circulation d’hommes, de femmes et de marchandises non prévues au programme, symptomatique de l’expérience coloniale elle-même.
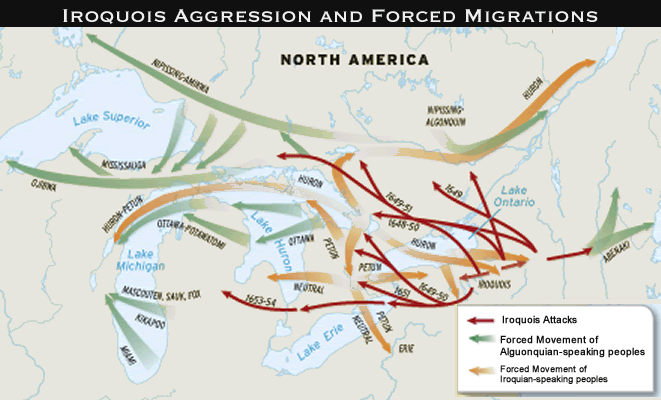
Hormis ce fait saillant transfrontalier, le champ migratoire le plus significatif fut sans aucun doute la crise de réfugiés amérindiens, qui eut cours « en contre-choc du marteau des Iroquois »[48] de la vallée du Saint-Laurent aux Pays d’En Haut, avec des effets ressentis jusqu’en Louisiane[49]. Compte tenu l’évolution des alliances franco-indiennes dans les rapports de force continentaux, ce bouleversement migratoire sur un aussi vaste territoire eut sans doute une incidence sur les développements ultérieurs de la politique territoriale du roi de France en Amérique, avec le commerce des fourrures comme adjuvant, ou trame de fond.
D’une certaine façon, tout le paradigme de l’histoire atlantique se fait sous la coupe de l’histoire transfrontalière. Ainsi, le phénomène protéiforme des circulations réveille la vieille histoire des rapports de force de son sommeil embaumé: les phénomènes des alliances franco-indiennes, du déploiement de l’Empire français sur le continent, du mouvement des marchandises et des populations, ou encore des reconfigurations culturelles issues du « middle ground », firent de la Nouvelle France une zone de circulation aux frontières culturelles et territoriales constamment renégociées, beaucoup plus qu’une unité politique dont les frontières n’étaient visibles qu’à Versailles. Et l’aire atlantique vu sous l’angle des migrations économiques, ressemble plutôt à un global marketplace – un océan parasité par le commerce triangulaire – qu’à une épopée héroïque !
Pour terminer, revenons au point de départ. Avec les partis-pris de nos cadres d’interprétation à l’esprit, il est désormais possible de discerner les raisons de la disparition (ou dissolution) de ce qui fut jadis un « fait structurant » de l’histoire du Canada, la traite des fourrures. Aujourd’hui les cadres historiographiques ne sont plus fixes, ils sont mobiles, et se comparent. À l’instar de Burnard, de Charles et de Wien, nous souhaitons envisager la problématique de la traite illicite des fourrures au carrefour de l’histoire transfrontalière et de l’histoire impériale, dans un chiasme croisant héritage et expérience. S’il n’est plus possible de nous cantonner, comme Innis, au seul point de vue du « développement historique », prenons plutôt le pari du risque avec la densité d’interrogations, d’intérêts contradictoires et de malentendus porteurs que la voie comparative nous propose, plus riche en perspective(s).
Notes
[1] Greer, Allan, « L’historiographie de la Nouvelle-France présentée aux historiens des États-Unis », dans A. Greer, La Nouvelle-France et le monde (Montréal, Boréal, 2011), p. 25.
[2] Lionel Groulx, “Histoire du Canada français depuis la découverte”, Ligue d’action nationale, Montréal,1950, Vol 2, p. 136.
[3] Dans son magnum opus sur l’histoire de la traite des fourrures au Canada, Innis cherche à restituer la traite dans son ensemble comme une activité aux mobiles économiques, et dont il faut rendre compte avec des critères économiques. Son analyse de la traite illégale demeure campée dans ce moule. Par exemple, l’origine du phénomène de la contrebande systématique, selon lui, fut occasionnée par des changements dans la structure des marchés européens, avec des répercussions sur l’offre et la demande des fourrures dans le contexte colonial français et anglais. Harold Innis, « The Fur Trade in Canada », University of Toronto Press, 1970 (1930), p. 77-82.
[4] Ou du moins avec des frontières en perpétuelle renégociation…
[5] Allan Greer souligne à la fois l’aspect novateur et orthodoxe de l’œuvre d’Innis, en ajoutant qu’un consensus critique existe aujourd’hui chez les historiens pour invalider ses schémas d’interprétation réducteurs de la traite. Greer, p. 24-25.
[6] Greer cite les travaux de l’historien canadien W.J. Eccles à titre d’exemple d’une critique soutenue des thèses « déterministes » de H. Innis. Greer, L’historiographie de la Nouvelle-France, p. 24.
[7] Roy, G., « Mercantilisme et colbertisme : rapport de lecture », dissertation fournie à T. Wien dans le cadre du HST 3700 : lectures dirigées, Université de Montréal, 2016.
[8] Barth, Jonathan, « Reconstructing Mercantilism: Consensus and Conflict in British Imperial Economy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries », William and Mary Quarterly, 73, 2 (2016): 257-290.
[9] Pincus, Steve, « Rethinking Mercantilism: Political Economy, the British Empire, and the Atlantic World in the Seventeenth and Eighteenth Centuries ». The William and Mary Quarterly 69, no 1 (1 janvier 2012) : 3-34.
[10] Pincus et Barth vont se pencher tous deux, chacun à sa façon, sur les débats métropolitains et coloniaux concernant les politiques économiques du premier Empire britannique.
[11] Comme Pincus le note, la plupart des historiens depuis Hecksher on fait une recension de la critique anti-mercantiliste en vogue depuis les Lumières, soit pour accepter l’idée du consensus, ou pour le rejeter. Pincus, p. 5-8.
[12] Pincus, p. 3-4.
[13] Pour Hecksher, le mercantilisme était une « phase de transition », du (féodalisme) médiéval au (laissez-faire) moderne. En contrepartie, pour les historiens de l’Empire tels J.F. Rees, le mercantilisme était tout simplement l’expression économique d’un nationalisme militant. Pincus, p. 5-6.
[14] Pincus, p. 7.
[15] « Mercantilism, from the moment of the consolidation of academic disciplines, has remained one of the fundamental organizing principles of historical inquiry. Because early moderns shared basic economic ideas, they never had any reason to argue about the basics of economic and imperial policy. There could be, and were, local and pragmatic disputes about timing and extent, but the overall framework in which early modern policy makers operated was—according to the overwhelming majority of scholars—rarely an issue for political and ideological debate. Early moderns, presumably, reserved their ideological disagreements for the realms of religion and constitutional arrangements. Party politics was not about the everyday secular life of the mass of the population. » Pincus, p. 12.
[16] Pincus, p. 8-9.
[17] N’en demeure qu’il faut s’interroger, à titre d’historien, sur l’importance relative des idéologies qui motivèrent cette expansion, et la teneur commerciale de celle-ci. Et c’est dans leur façon de caractériser le consensus mercantiliste – soit dans la foulée de l’historiographie critique, soit selon les préceptes économiques courants du XVIIe et XVIIIe siècles – que nos deux commentateurs se démarquent l’un de l’autre.
[18] Deux personnalités Tory éminentes de l’époque citées par Pincus : Sir Walter Ralegh, Sir Josiah Childs. Pincus, p. 15–18.
[19] Deux personnalités Whig éminentes de l’époque citées par Pincus : John Smith, et Carew Reynell. Pincus, p. 16-22.
[20] D’après Pincus, John Locke fut le premier intellectuel de renommée à proposer que la richesse pourrait s’accroitre sur la base d’une réorganisation et optimisation du travail, les fameux « facteurs de production » de Smith et de Marx. Pincus, p. 22.
[21] On pense ici à la formation des grandes compagnies maritimes, la Royal African Company, la Hudson Bay Company, et le Rupert’s Land. Pincus, p. 18-19.
[22] La création des « Dominions », par exemple. Pincus, p. 20.
[23] Pincus, p. 20-22.
[24] Pincus, p. 22-23.
[25] Barth, p. 263.
[26] Barth, p. 257.
[27] Voilà l’essentiel de la charge que Barth dirige contre le paradigme de l’histoire Atlantique: « No Atlantic historian has yet launched a detailed engagement with the larger historiographical debate about mercantilism, insulating the field from this highly significant question about the ideological basis for economic empire. » Barth, p. 261.
[28] Barth, p. 262.
[29] Barth, p. 267.
[30] Barth, p. 262.
[31] Barth, p. 262.
[32] Burnard, Trevor, « Empire matters? The historiography of imperialism in early America, 1492–1830 ». History of European Ideas 33, 1 (mars 2007): 87-107.
[33] À l’instar des tentatives de distinction culturelle des peuples de Hume et de Montesquieu, le fermier pionnier proto-américain St. John Crévecœur tentera une évaluation critique de l’Empire coloniale espagnol et anglo-saxon. À la Francis Parkman, il forcera les traits des caractères nationaux entre coloniaux anglais et espagnols de manière très prononcée : les anglais sont travaillants et éclairés, les espagnols, superstitieux et paresseux. Le seul problème : les planteurs du Sud des États-Unis et de la Jamaïque font partie de l’Empire britannique. Burnard, p. 87-90.
[34] L’exercice de caractérisation du colon Crèvecœur achoppe sur le problème typologique des différents secteurs d’un même empire, et des facteurs de différenciation entre empires. L’exercice comparatif, qui devrait mener à des typologies nationalistes claires, met celui qui l’exerce dans l’embarras en ce qui concerne les points de similitudes et de différences entre les empires rivaux, vu de l’intérieur de chacun. Burnard, p. 90.
[35] « It is almost a matter of faith among Atlantic historians that Atlantic history is not imperial history. They tend to privilege experience (what happened in the transit to the New World) over inheritance (the memories and histories of the places left behind) in their treatment of different areas in the Americas ». Burnard, p.91.
[36] L’histoire atlantique « ne saurait être euro centrique – ni en l’occurrence afro centrique, ou américano-centrique ». Burnard, p. 91.
[37] Burnard, p. 91.
[38] …à l’exception de l’Afrique, réservée à la guerre et au pillage des populations.
[39] Burnard, p. 92.
[40] Burnard, p. 93.
[41] « Andrews, like the authors of the Cambridge History, identified the passage of the 1713 Treaty of Utrecht as a crucial moment in the consolidation of mercantilist colonial policy. “From this time forward,” Andrews concluded, “the colonies, in constantly accelerating measure, became a necessary asset in mercantilist eyes.” Though there could be and in fact were intense debates over particular policies, these disputes were ephemeral because there was such widespread agreement over the fundamentals. There were no deep-seated ideological disagreements surrounding the formation of the British Empire. » Pincus, p. 7.
[42] Idem pour notre cas, l’histoire de la Nouvelle France. Dans un essai faisant état des lieux des nouvelles tendances historiographiques portant sur la Nouvelle France, Allan Greer souligne que nous n’en sommes qu’aux débuts du décloisonnement des histoires nationales… Greer, Introduction, p. 7-13.
[43] Charles, Aline et Wien, Thomas, « Le Québec entre histoire “connectée” et histoire transnationale », Globe : Revue internationale d’études québécoises, 14, 2 (2011) : 199-221.
[44] Et de manière rétroactive.
[45] On n’a qu’à ouvrir n’importe quel manuel d’histoire pour obtenir une piqure de rappel sur l’écart démographique entre la Nouvelle France et la Nouvelle Angleterre, des débuts de la colonisation jusqu’à la cession de la Nouvelle France à l’issue de la guerre de Sept Ans.
[46] Retenons que dans toute la période colonisatrice, seulement 30 % des émigrés français optèrent de s’établir au Nouveau Monde. Et c’est sans compter ceux qui choisirent « l’exil intérieur » et l’aventure dans… la traite et la course des bois !
[47] Charles, Wien, p. 216.
[48] Pour reprendre l’expression de Richard White, paru dans le premier chapitre de son ouvrage « Middle Ground ».
[49] Charles, Wien, p. 216.
Bibliographie
Barth, Jonathan, « Reconstructing Mercantilism: Consensus and Conflict in British Imperial Economy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries », William and Mary Quarterly, 73, 2 (2016): 257-290.
Burnard, Trevor, « Empire matters? The historiography of imperialism in early America, 1492–1830 ». History of European Ideas 33, 1 (mars 2007) : 87-107.
Charles, Aline et Wien, Thomas, « Le Québec entre histoire “connectée” et histoire transnationale », Globe : Revue internationale d’études québécoises, 14, 2 (2011) : 199-221.
Greer, Allan, « L’historiographie de la Nouvelle-France présentée aux historiens des États-Unis », dans A. Greer, La Nouvelle-France et le monde (Montréal, Boréal, 2011), p. 17-46.
Harold Innis, « The Fur Trade in Canada », University of Toronto Press, 1970 (1930).
Pincus, Steve, « Rethinking Mercantilism: Political Economy, the British Empire, and the Atlantic World in the Seventeenth and Eighteenth Centuries ». The William and Mary Quarterly 69, no 1 (1 janvier 2012) : 3-34.


Laisser un commentaire